18 octobre 2009
Porcupine Tree, Olympia, 13/10/2009

J'ai le sentiment d'avoir tout dit sur le groupe, car les concerts n'ont pas manqué ces dernières années dans notre belle capitale (Elysée-Montmartre en 2006, Cigale puis Olympia en 2007).
Le plaisir de les retrouver pour la deuxième fois à l'Olympia semblait partagé puisque Steven Wilson s'est encore fendu d'un petit speech sur l'honneur que cela représente pour son groupe de jouer dans une salle si mythique ; par ailleurs la présence de ses parents aux place n°1 et 2 du premier rang de la mezzanine en disait long sur l'importance donnée à ce concert. Côté VIP, on a pu aussi apercevoir les membres de Marillion, qui devaient jouer le lendemain au Bataclan.
Le concert était composé de deux sets séparés par un entracte de 10 minutes. Le premier set était sans surprise constitué de l'intégralité du cycle de 55 minutes The Incident, composé de 14 titres à la base enchaînés sur album, mais ponctués ici de courtes pauses, changement d'instruments oblige. Le gros problème de ce cycle est le déséquilibre majeur entre ses différentes pistes, une part beaucoup trop importante affichant entre 1 et 2 minutes, ce qui donne l'impression d'idées non achevées. C'est frustrant, et au final sur 14 pistes il n'y a que 6 pistes qui ressemblent à de vraies chansons (d'une durée supérieure à 4 minutes). De surcroît, elles sont loin d'être toutes aussi inspirées que les œuvres passées de Porcupine Tree. Tout cela reste plaisant à écouter (Drawing The Line et son refrain particulier passant ainsi mieux en live), mais le seul véritable grand moment, sur disque comme sur scène, reste le plat de résistance Time Flies, avec son rythme très entraînant et hypnotique, son break hyper floydien et ses paroles délicieusement nostalgiques.
Le deuxième set fut heureusement parfait de bout en bout (accentuant ainsi au passage la différence de niveau entre les nouvelles compositions et les anciennes...), brassant intelligemment albums, classiques et raretés. Une pépite de Deadwing a ainsi été exhumée (The Start Of Something Beautiful) avec délice. Deux morceaux très longs, Russia On Ice (plus joué depuis combien d'années ?) et Anesthetize (devenu un véritable classique remportant la première place à l'applaudimètre) ont été raccourcis intelligemment et enchaînés avec goût. Strip The Soul, choix solide tiré de In Absentia, n'avait plus été joué depuis la tournée supportant l'album. Grosse surprise et gros succès aussi avec Normal, jamais joué sur la tournée précédente avec tout le groupe. Cette fantastique variation sur les paroles et la mélodie principale de Sentimental, disponible sur l'EP Nil Recurring sorti peu de temps après Fear Of A Blank Planet, a largement remporté l'adhésion du public. The Incident, c'est aussi un double album et Wilson a eu la bonne idée de jouer sur cette tournée le titre le plus solide du deuxième CD, à savoir le dynamique et intrigant Bonnie The Cat, qui nous a offert encore une superbe démonstration de bon goût du monstrueux batteur Gavin Harrison.
Les inamovibles Lazarus et Trains sont devenus des hymnes rituels, mais dont on ne lasse pas tellement ils sont gorgés d'émotion. Finalement, chaque euro dépensé dans ce cher Olympia valait encore le coup, ne serait-ce que pour ce deuxième set qui restera longtemps dans les mémoires.
Setlist:
Set 1
The Incident
Set2
The Start of Something Beautiful
Russia on Ice
Anesthetize
Lazarus
Strip the Soul
.3
Normal
Bonnie The Cat
Rappels:
The Sound of Muzak
Trains
11:36 Publié dans Concerts | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : concert, porcupine tree, olympia
The Hurt Locker
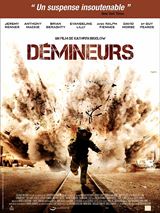
Kathryn Bigelow doit être la seule femme à Hollywood réalisant des films d'action ; on lui doit les cultes Point Break et Strange Days, et son dernier long-métrage remontait à 2002 avec le mitigé K-19, film de sous-marin russe avec Harrison Ford.
Elle revient ici en très grande forme avec un film sur la deuxième guerre en Irak, genre rapidement accaparé par Hollywood après l'invasion déclenchée par Bush fils. Heureusement, The Hurt Locker (Démineurs en français ; le hurt locker désignant la combinaison de bibendum revêtue par les démineurs pour se protéger un petit peu en cas d'explosion) est probablement le seul à pouvoir être mis dans le même panier que Redacted, qui était jusqu'à présent le seul film d'envergure sur le sujet.
Même si Bigelow n'ambitionne pas d'aller se frotter à De Palma sur le plan de la conceptualisation de la mise en scène, elle transforme ce qui aurait pu être un blockbuster guerrier bourrin en une touchante chronique de rapports humains de soldats qui font un travail très peu enviable. Bigelow se pose en observatrice et ne prend jamais parti, que ce soit pour les Américains ou les Irakiens. L'action est réduite à sa plus simple expression : en égrenant le nombre de jours qui restent à l'équipe avant de rentrer au pays, on observe ces soldats se confronter quotidiennement à des bombes à désamorcer dans des situations toujours très diverses et qui ressemblent souvent à des traquenards.
Bigelow place ainsi le spectateur dans des situations anxiogènes à l'extrême, grâce à un mélange savant de visions subjectives, de claustrophobie, de sensations désagréables (souffle des explosions, poussière, chaleur écrasante). Le tout est servi par des images magnifiques, avec des plans au cadrage très étudiés. Les acteurs, dont les têtes sont inconnues (bien qu'il y ait des cameos savoureux), vivent totalement leurs personnages ambigus et renforcent ainsi le sentiment de réalisme.
Kathryn Bigelow confirme ainsi son statut de réalisatrice de blockbusters indéniablement divertissants, mais surtout diablement originaux et fichtrement en marge de ses collègues masculins.
8/10
10:43 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, kathryn bigelow, jeremy renner, anthony mackie, brian geraghty
11 octobre 2009
(500) Days of Summer

Marc Webb est connu pour ses clips musicaux ; Maroon 5, My Chemical Romance, Incubus, Lenny Kravitz, Green Day, Coheed And Cambria ou encore Evanescence ont tous fait appel aux services du jeune réalisateur américain. Pour son premier long-métrage, il a choisi de s'attaquer à une comédie romantique, genre qui ne doit pas compter beaucoup de chefs-d'œuvres.
Pour échapper aux clichés, Webb et son scénariste ont choisi une structure narrative non linéaire (effeuillage des 500 jours dans le désordre), ce qui permet de renverser immédiatement la situation : on sait d'emblée que l'histoire d'amour va mal finir, et le film se propose plus de livrer - avec malice, humour et souvent gravité - l'anatomie de cette histoire du boy meets girl, histoire plus acide que sucrée. On échappe donc à toute mièvrerie, et Marc Webb s'avère être un réalisateur plein d'idées originales de mise en scène (ex. : l'utilisation géniale du split screen, l'incursion inattendue d'une scène de comédie musicale pour décrire le sentiment de griserie du personnage masculin), n'hésitant pas à sortir des sentiers battus, avec beaucoup d'énergie ; bref, à suivre.
Le titre du film a encore été traduit avec malheur : de (500) Days of Summer, on passe à (500) Jours ensemble, ce qui fait perdre intégralement le jeu de mots, puisque Summer est le prénom du personnage principal interprété par Zooey Deschanel. Or c'est bien sur son personnage que repose la saveur du film ; à la fois ingénue et furieusement insaisissable, échappant à toute rationalité masculine, elle incarne avec perfection (et un charme fou) l'amour impossible. Dommage que Joseph Gordon-Levitt soit quant à lui un peu fade dans le rôle principal masculin.
Enfin, le film est éminemment sympathique par ses références musicales, qu'il aurait été étonnant de ne pas trouver au vu du pedigree de Marc Webb. L'univers est donc ultra-référencé (Joy Division et The Clash apparaissent sur des t-shirts, les Smiths sont un sujet de conversation, un album solo de Morrissey est visible dans les chambres des deux personnages du couple, et Ringo Starr fait l'objet d'une blague récurrente). La B.O. n'est pas en reste avec The Smith, The Clash, Simon & Garfunkel et même Carla Bruni (ce qui n'a pas manqué de faire sourire par chez nous, évidemment).
Marc Webb n'a désormais plus qu'à s'attaquer à un sujet plus consistant, et à abandonner quelques tics du cinéma indépendant américain, et son prochain film devrait lui valoir une belle reconnaissance.
7/10
11:10 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, marc webb, joseph gordon-levitt, zooey deschanel
10 octobre 2009
Dream Theater, Zénith, 04/10/2009

Pour son 6e concert au Zénith depuis 2000, Dream Theater est arrivé avec sa formule du mini-festival Progressive Nation, dont l'affiche européenne est hélas moins alléchante que son homologue américain de l'été dernier (Zappa Plays Zappa étant d'un autre calibre). Du coup, même si l'ensemble de la soirée a proposé de la musique live de 18h30 à 23h00, je ne parlerai que de DT, car les autres groupes ne sont pas du tout ma tasse de thé et je ne les ai même pas vus, j'ai juste entendu un peu d'Opeth. Le set de DT était donc réduit à 1h30, ce qui est durée ridicule pour un groupe habitué à proposer minimum 2h30 de musique, et qui est monté à 3h30 (record absolu, atteint dans ce même Zénith le 29/01/2004).
La difficulté tient donc au choix des titres à loger dans la setlist, surtout quand il y en a d'office qui sont plutôt longs, comme le rappel sur toutes les dates, The Count Of Tuscany, qui affiche 20 minutes. Le choix de Mike Portnoy pour la tournée actuelle se concentre principalement sur les trois derniers albums, avec un petit détour sur Awake (les paires The Mirror/Lie et Erotomania/Voices alternent suivant les villes), et des emprunts très ciblés variant entre Scenes From A Memory, Falling Into Infinity et Images And Words.
Pour mon 37e concert du groupe (blasé ? non car désormais je les vois une fois tous les deux ans, ce qui est parfait), la setlist ne fut guère ma tasse de thé (doux euphémisme ; et mention spéciale au solo de claviers totalement inutile dans le contexte d'un concert d'1h30!), mais le déplacement valait le coup ne serait-ce que pour le dantesque dyptique The Mirror/Lie, maître-étalon de ce DT a su composer de plus concis, puissant, sombre et mélodieux dans toute sa carrière. Les titres des années 2000 accusent donc le coup face à ce chef d'œuvre impérissable qui file le frisson assuré, mais je conviens que les titres récents restent tout de même plus agréables sur scène que sur disque. En effet, James LaBrie était en forme, et le groupe bénéficie toujours d'un son aussi propre que puissant dans ce Zénith qu'ils maîtrisent totalement. Le spectacle de leurs capacités techniques est toujours au rendez-vous et la machine DT tourne toujours à plein régime, comme si le temps qui passe n'avait aucune emprise. Que demande le peuple ? Plus d'audace pour les prochains albums ? Oui, certes... mais c'est un tout autre sujet.
Setlist :
A Nightmare To Remember
The Mirror
Lie
A Rite Of Passage
Keyboard solo
Wither
The Dance Of Eternity
In The Name Of God
Rappel:
The Count Of Tuscany
22:21 Publié dans Concerts | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : concert, dream theater, zenith
03 octobre 2009
District 9

District 9 est le premier long-métrage du néo-zélandais Neill Blomkamp (le réalisateur de l'avant-gardiste pub de 2004 pour la Citroën C4 qui se transforme en robot dansant, bien avant le film Transformers de Michael Bay). Son compatriote Peter Jackson a fait office de producteur, en lui allouant un budget de 30 millions de dollars pour réaliser son premier film.
Le moins que l'on puisse dire, c'est le bonhomme est très prometteur. Outre l'aura de son célèbre parrain, il accumule les bons points : un pitch original (des extraterrestres arrivés sur Terre en 1982 sont parqués dans un township de Johannesburg, le district 9, où ils se reproduisent, deviennent ingérables et on entreprend de les déménager dans un camp d'accueil digne de ce nom), un style faux documentaire, low-fi, rappelant le principe faussement amateur à la YouTube vu dans Cloverfield, des acteurs totalement inconnus (la plupart n'étant pas acteurs de profession), ou encore des effets spéciaux portant la marque de l'artisanal (budget réduit oblige), mais diablement plus crédibles qu'un truc de Lucasfilm.
Le film démarre sur les chapeaux de roue, grâce à l'exploitation parfaite du programme annoncé : les habitants de Johannesburg dénoncent la situation invivable engendrée par les réfugiés aliens, espèce de grandes "crevettes" repoussantes qui grouillent souvent à l'arrière-plan. Grâce au montage faux-documentaire (interviews, extraits de faux journaux, fausses archives etc.), on est immergé immédiatement dans cette uchronie dont on peut s'étonner que personne n'en avait encore eu l'idée. Le choix de Johannesburg plutôt qu'une grande métropole occidentale est brillant, car la pollution et la crasse des bidonvilles humains et aliens tissent une métaphore un peu grosse mais qui donne au film une tout autre connotation que simplement SF : en filigrane, c'est évidemment l'Apartheid qui est évoquée. L'homme est un loup pour l'homme, mais il est encore pire envers l'alien ; petit à petit, la situation sera retournée, le plus hideux n'étant pas forcément celui étant le plus repoussant physiquement.
Il convient de pas en dire plus afin de ne pas atténuer les nombreuses bonnes surprises de ce premier coup d'essai remarquable, à la puissance visuelle et à l'inventivité énergique rares. Le seul défaut de District 9, c'est probablement de tenter d'explorer trop de directions à la fois, comme si Blomkamp avait voulu déverser toutes les idées accumulées depuis des années. District 9 ressemble à un croisement monstrueux entre Carpenter, Verhoeven et Cronenberg. C'est sa force mais aussi sa limite, les 1h50 sont presque frustrantes tant il y avait à encore à dire.
8/10
12:55 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : cinéma, neill blomkamp, sharlto copley


